000
100
%
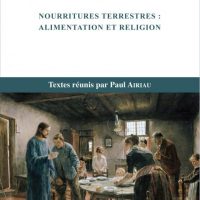
S’« il faut manger pour vivre et non vivre pour manger », à suivre Molière, il faut tout autant, et peut-être davantage, croire pour manger. Que l’Occident contemporain l’ait assez largement oublié permet désormais aux historiens de ces temps qui sont les nôtres (c’est-à-dire depuis la fin du xviiie siècle) et attentifs au religieux de se saisir d’un sujet qu’ils ont encore trop peu traité, car il échappait à leurs préoccupations. En effet, nombre d’entre eux, des années 1960 aux années 2000, ont appartenu à ou sont issus d’une version modernisatrice du courant religieux qu’ils ont étudié. La relative identification de l’alimentation majoritaire à l’alimentation chrétienne (voire catholique) et la concomitance de leurs mutations ont fait que la question alimentaire ne fut jamais qu’un non sujet, tant elle est quotidienne, banale, normalisée – et, dans le cas du judaïsme, elle était tellement évidente qu’elle ne pouvait non plus être l’objet d’une approche historique. De plus, les modifications des manières religieuses de manger après la Seconde Guerre mondiale et Vatican II, marquées par une massive dérégulation institutionnellement organisée des pratiques d’abstinence et de jeûne, ont été comprises comme un accès à une religion intériorisée et épurée, articulée à l’entrée dans une forme de modernité alimentaire permise par l’agro-industrialisation et les prodromes de la mondialisation alimentaire (disponibilité en abondance, hors saisons et hors zones de production). Enfin, peut-être surtout, l’alimentation n’a jamais vraiment été objet de conflits herméneutiques et donc d’approches historiques, tant la réflexion et l’enquête sur l’ascèse se sont focalisées sur l’autre grand sujet du plaisir – le sexe. Faut-il alors s’étonner que le sujet n’ait pas suscité de grandes investigations ?